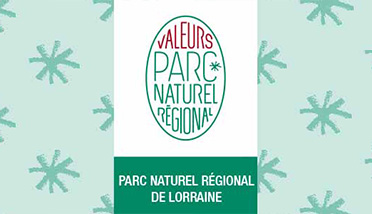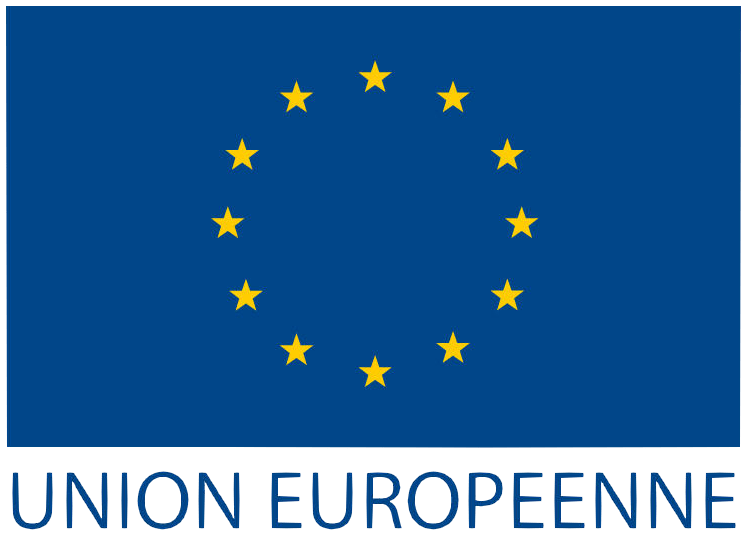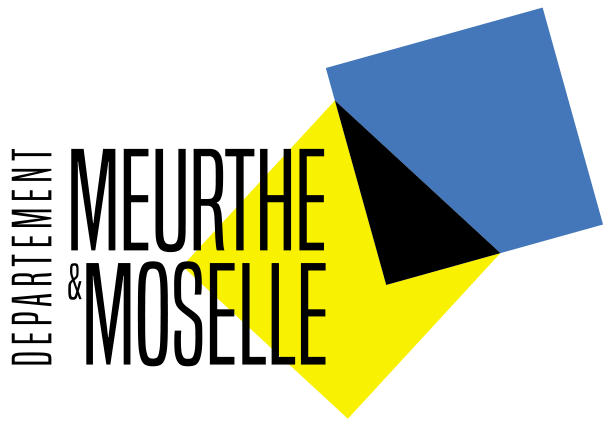Des métiers au service du territoire
Entretien avec Ronan Joncour
Adjoint à la responsable de pôle et chargé de mission éducation au territoire

Ton coup de cœur sur le Parc ?
“J’aime les reliefs calcaires des côtes, les paysages d’étangs, et surtout la vallée de l’Esch, près de chez moi : forêts, prairies, rivière… un condensé de nature. Je fais beaucoup de vélo, parfois sur de longues distances, parfois simplement pour venir travailler.
Pour moi, le vélo est une magnifique façon de découvrir le territoire, comme la marche. Découvrir un lieu, c’est prendre le temps de l’observer, d’écouter ceux qui y vivent. Au fond, que l’on soit à pied ou à vélo, l’essentiel reste le même : créer du lien et repartir avec un bon souvenir.
Ronan, tu es arrivé au Parc naturel régional en 1997 en tant qu’objecteur de conscience. Un statut qui, aujourd’hui, parle peut-être moins aux jeunes générations…
À l’époque, l’objection de conscience était une alternative au service militaire obligatoire. Je ne souhaitais pas porter les armes, et ce statut me permettait de m’investir dans des ONG ou des associations. C’est comme ça que j’ai rejoint le Parc, sans vraiment savoir ce qui m’y attendait.
Et depuis, tu n’as plus quitté le Parc ! Peux-tu nous retracer ton parcours ?
Ça fait effectivement plus de vingt-cinq ans. J’ai commencé comme animateur nature à la Maison du Pays des Étangs, à Tarquimpol. Puis, je suis revenu à la maison du Parc pour travailler sur un programme d’animations thématiques pour les écoles du territoire, le Club Parc. Ce programme a ensuite évolué pour devenir La Nature au Futur, puis Connais ton Parc. En parallèle, j’animais le réseau d’acteurs en éducation au territoire, un mélange d’animations pour les écoles et d’accompagnement des structures qui accueillent et sensibilisent le public.
Ton métier a-t-il beaucoup changé depuis ?
Pas fondamentalement. Je continue de soutenir le réseau, en aidant à construire et à faire connaître son offre d’accueil. Nous avons même mis en place une charte éducation, qui garantit la qualité des animations proposées. Mon quotidien reste varié : animation sur le terrain, formation, création d’outils pédagogiques, recherche de financements, communication… et, bien sûr, une bonne dose de logistique et d’administratif !
Tu es désormais adjoint dans un tout nouveau Pôle. En quoi consiste ton rôle ?
Ce pôle rassemble des métiers qui, chacun à leur manière, valorisent le territoire. Mon rôle est d’aider la cheffe de pôle à coordonner ces différentes approches. Nous sommes encore en train de trouver notre équilibre, car chacun travaille avant tout dans son domaine de prédilection.
Qu’est-ce qui te plaît le plus dans ton travail ?
Sans hésiter : être dehors, au contact de la nature et des gens. J’aime transmettre, faire le lien entre un patrimoine – qu’il soit naturel, paysager ou culturel – et le public.
Te considères-tu plutôt comme un spécialiste de la nature ou du patrimoine ?
Je me vois comme un généraliste. Je ne suis pas un expert pointu dans un domaine en particulier, mais j’essaie d’avoir une vision globale pour éviter de dire des bêtises. Et j’ai un faible pour les petites bêtes : chauves-souris, insectes… tout m’intéresse !
L’éducation au territoire, c’est quoi ?
C’est une notion plus large que l’éducation à l’environnement. Elle englobe tous les patrimoines : naturels, culturels, bâtis. Cela nous permet de collaborer avec des musées, des associations locales… C’est une approche globale et inclusive.
Quelle est ta « recette » pour transmettre efficacement ?
D’abord, bien connaître son sujet et surtout écouter. Ensuite, partir des connaissances du public pour l’emmener plus loin. Enfin, susciter l’émerveillement, car c’est ce qui donne envie d’agir pour la transition écologique.
Tu travailles avec des publics très variés. Comment abordes-tu des sujets parfois délicats ?
Les araignées, par exemple, ne font pas toujours l’unanimité. Mais en expliquant leur rôle dans la nature, notamment pour l’agriculture, on change la perception. Quand un agriculteur comprend leur utilité pour ses cultures ou ses prairies, il ne les voit plus comme une contrainte, mais comme un atout. C’est la même approche avec les touristes ou les enfants : l’important, c’est que chacun reparte avec une expérience positive.